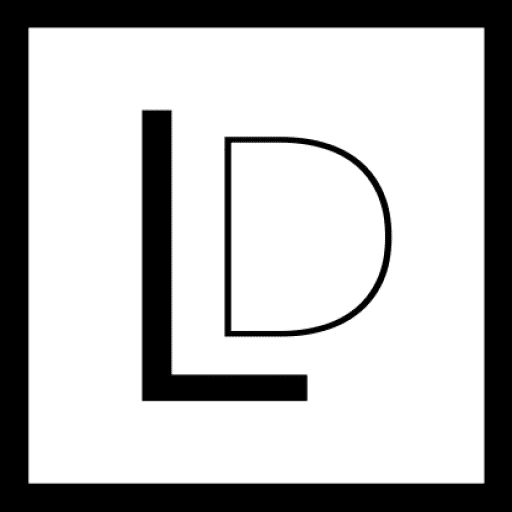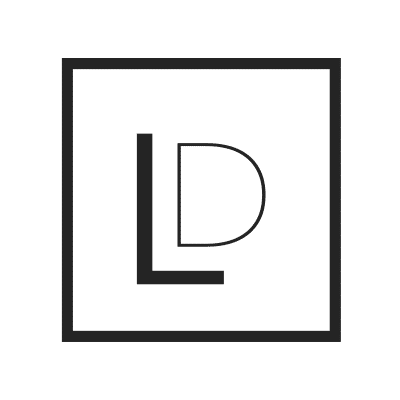Comment diagnostiquer et adapter l’utilisation des ressources de construction en guadeloupe ?
Retour aux publicationArticle scientifique dans le cadre du séminaire
Ludgi DraconDomaine d'Etude : Hospitalité et Soutenabilité - Marseille - Automne 2018
Travail co-écrit avec Valérie Movizzo
Télécharger le pdf
La Guadeloupe est un territoire limité et isolé. 91% des ressources sont importés depuis les autres pays. Ce qui en fait un territoire sensible à la crise écologique. Les ressources sont présentes sur ce territoire, mais elles ne sont pas ou peu exploitées au vu de leur accessibilité ou de leur quantité. L’hybridation des modes constructifs et la mise en place des circuits courts et/ou d’une économie circulaire peuvent-ils être une solution durable pour l’avenir des territoires isolés ou limités ?
Mots-clés :ressources, territoire limité, isolé, Guadeloupe, durables, circuit court, hybridation, économie circulaire.
1 – Introduction
Aujourd’hui notre monde se complexifie, permettant et facilitant les échanges entre les pays les plus éloignés. Même les plus petites îles n’échappent pas à la mondialisation. C’est le cas de la mienne : la Guadeloupe, petit bout de terre en forme de papillon nageant dans les eaux des Caraïbes. Chaque année nous importons pour 2,6 milliards d’euros contre 200 millions d’exportations. La Guadeloupe est dépendante au reste du monde, cela la rend fragile en cas de crise. Nous allons nous concentrer sur le domaine de la construction, plus précisément celui de l’habitat. Car, même si la population est en train de diminuer depuis ces 15 dernières années, le besoin en production de logements reste en augmentation.Cet article va nous permettre de faire un état des lieux des ressources présentes sur le territoire précédé d’une rapide présentation de l’île. Ensuite pour conclure nous allons dégager des pistes vers des ouvertures sur une utilisation des ressources de construction plus durable en Guadeloupe.
2 – Présentation générale de l’île
Au milieu des Petites Antilles, en face de l’Amérique centrale de l’océan Atlantique et la mer des Caraïbes, se situe mon île : la Guadeloupe. C’est un archipel constitué de deux îles principales dont l’ensemble fait 1780 m2.Surnommée « l’île aux belles eaux » par les Amérindiens, la Basse-Terre (848 km2) volcanique et montagneuse est séparée de la Grande-Terre (548 km2), île plate recouverte de roche calcaire, par un chenal marin appelé « la rivière salé ». Les autres îles communément appelées dépendances administratives sont :
- Marie Galante (158 km2),
- La Désirade (21 km2),
- Les Saintes, formé de terre de haut et terre de bas (13 km2).
- Saint Bathélémy (25 km2)
- Saint Martin (Partie nord 59km2), l’autre partie étant en possession hollandaise.
2.1 - Topographie et nature des sols
La topographie de la Guadeloupe se définit par une grande diversité. L’île de la Basse- Terre traversée, du nord au sud par une chaîne montagneuse où culmine la Soufrière (1467 m). L’île de la Grande-Terre est d’un relief plus écrasé, se répartit :
Les sols de Guadeloupe, à dominante argileuse, appartiennent ainsi à 4 grandes familles :
La topographie de la Guadeloupe se définit par une grande diversité. L’île de la Basse- Terre traversée, du nord au sud par une chaîne montagneuse où culmine la Soufrière (1467 m). L’île de la Grande-Terre est d’un relief plus écrasé, se répartit :
Les sols de Guadeloupe, à dominante argileuse, appartiennent ainsi à 4 grandes familles :
- Les sols, sur socle volcanique ancien (Nord de la Basse-Terre), avec une bonne rétention en eau, mais pauvres en silice et en matière organique.
- Les sols, sur socle volcanique récent (Sud de la Basse-Terre), à grande capacité de rétention en eau, fertiles et riches en matière organique peu dégradée.
- Les vertisols, rencontrés surtout sur substrat calcaire, fertiles, mais peu perméables, riches en argiles gonflantes, ils sont très sensibles à l’alternance des phases humides et sèches (importante rétractation des sols par forte chaleur)
- Les alluvions, dépôt argileux ou sableux émergé qu’ont laissé des eaux par des sédimentations successives
2.2 - Climat
La Guadeloupe bénéficie d’un climat tropical tempéré par les influences maritimes et les alizés.
On distingue deux saisons en Guadeloupe et dans les îles voisines :
La Guadeloupe bénéficie d’un climat tropical tempéré par les influences maritimes et les alizés.
On distingue deux saisons en Guadeloupe et dans les îles voisines :
- Une saison sèche, de janvier à juin,
- Une saison humide, qui s’étale de juillet à décembre (période cyclonique)
2.3 - Population
En 2017, l’Insee comptait un peu plus de 427 000 habitants, avec une densité de population de 246 hab/km2 en zone constructible (à titre comparatif : à Marseille la densité de population était de 3566 hab/km2).
En 2017, l’Insee comptait un peu plus de 427 000 habitants, avec une densité de population de 246 hab/km2 en zone constructible (à titre comparatif : à Marseille la densité de population était de 3566 hab/km2).
2.4 - Economie
Le principal secteur économique est l’agriculture, secteur hérité de l’histoire de l’île au 18e siècle et 19e siècle avec le développement des habitations agricoles coloniales. La majeure partie de la surface agricole (environ 50 000 ha) est consacrée aux cultures dites d’exportation. Les cultures fruitières et maraîchères ne parviennent pas, quant à elles, à couvrir les besoins des Guadeloupéens. Mais la profusion des supermarchés masque ces faiblesses. Le secteur agricole survit aujourd’hui grâce aux subventions venant de l’Europe. Le second secteur est celui de la transformation des produits agricoles (rhum, sucre, ou eaux) suivi par le secteur tertiaire, divisé en deux branches : le secteur public et le tourisme. Deux secteurs nécessitant sans cesse de nouvelles constructions.
Le principal secteur économique est l’agriculture, secteur hérité de l’histoire de l’île au 18e siècle et 19e siècle avec le développement des habitations agricoles coloniales. La majeure partie de la surface agricole (environ 50 000 ha) est consacrée aux cultures dites d’exportation. Les cultures fruitières et maraîchères ne parviennent pas, quant à elles, à couvrir les besoins des Guadeloupéens. Mais la profusion des supermarchés masque ces faiblesses. Le secteur agricole survit aujourd’hui grâce aux subventions venant de l’Europe. Le second secteur est celui de la transformation des produits agricoles (rhum, sucre, ou eaux) suivi par le secteur tertiaire, divisé en deux branches : le secteur public et le tourisme. Deux secteurs nécessitant sans cesse de nouvelles constructions.
2.5 - Risques naturels
Les deux principaux risques auxquelles la Guadeloupe est régulièrement exposée sont les cyclones et les séismes. En 1843, le séisme qui s’est manifesté a déclenché un incendie qui provoqua la mort de plus de 3000 personnes à Pointe-à-Pitre. Bien que les morts dues à l’effondrement des bâtiments soient fréquemment constatées dans les zones urbaines, ce sont les effets secondaires qui sont les plus dévastateurs.
L’autre cataclysme dévastateur est le cyclone ou typhon (Chine, Japon). Leurs vents peuvent atteindre 230 km/h (cyclone de 1928).
Les deux principaux risques auxquelles la Guadeloupe est régulièrement exposée sont les cyclones et les séismes. En 1843, le séisme qui s’est manifesté a déclenché un incendie qui provoqua la mort de plus de 3000 personnes à Pointe-à-Pitre. Bien que les morts dues à l’effondrement des bâtiments soient fréquemment constatées dans les zones urbaines, ce sont les effets secondaires qui sont les plus dévastateurs.
L’autre cataclysme dévastateur est le cyclone ou typhon (Chine, Japon). Leurs vents peuvent atteindre 230 km/h (cyclone de 1928).
3 – Le cas d’un territoire isolé : La Guadeloupe
La Guadeloupe est une île, isolée et limitée géographiquement par la mer.Isolé : Qui est à l’écart.
On parle alors de milieu insulaire. Elle se situe à 575 km au nord des côtes du Venezuela en Amérique du Sud, à 739 km à l’est-sud-est de la République dominicaine, à 2 176 km à l’est-sud-est de Miami (États-Unis) et à 6 732 km de Paris.
Actuellement la Guadeloupe alimente un commerce déficitaire, c’est-à-dire qu’elle importe plus qu’elle n’exporte. À hauteur de 91% d’importation contre 9% d’exportation pour le flux des échanges commerciaux, les principaux clients sont la métropole et l’Europe. En ce qui concerne les matériaux de construction les principales importations sont : Les matériaux de construction et produits minéraux, bois, articles en bois, produits sidérurgiques et de première transformation de l’acier.
3.1 - État des lieux de la ressource en Guadeloupe
Depuis 1930, la majorité des constructions sont construites en béton armé. L’habitat individuel Guadeloupéen est une synthèse des époques passées et associe bois et corps en béton armé. Le ciment et les aciers de construction sont importés et les granulats durs d’origine volcanique (pouzzolane) nécessaires au béton, sont fournis par les deux principales carrières de la Basse-Terre. Nous allons nous concentrer sur les matériaux qui touchent et qui peuvent toucher le secteur de la construction en Guadeloupe.Les besoins spécifiques de la Guadeloupe en produits et matériaux de construction/rénovation, de même que le contexte socio-économique insulaire notamment lié à l’emploi et aux coûts des matières premières (en particulier « carbonées », importées) laissent penser que des productions locales contribueraient à apporter de nouvelles réponses mieux adaptées problématiques actuelle.
La nécessité d’identifier les potentiels les plus pertinents en termes de ressources insulaires mobilisables, les potentiels de produits et matériaux de constructions le cas échéant à développer se sont logiquement imposés.
La nécessité d’identifier les potentiels les plus pertinents en termes de ressources insulaires mobilisables, les potentiels de produits et matériaux de constructions le cas échéant à développer se sont logiquement imposés.
3.1.1 - Le bois
En Guadeloupe 18 espèces d'arbres sont principalement exploitées pour leur bois, essentiellement en ébénisterie, en menuiserie et dans une moindre mesure pour la charpente marine et les canots traditionnels. Les besoins en bois de construction sont eux entièrement couverts par les importations (estimés à plus de 60.000 m3 en 2013). Seules deux essences bénéficient d'une sylviculture dans un objectif de production de bois d'œuvre : le Mahogany à grandes feuilles et le Laurier rose.Un objectif de production de bois concerne moins de 8% de la forêt publique. Mais bien que marginal en termes de surface occupée (environ 3 000 ha), cet objectif est essentiel pour alimenter la filière bois locale. Le potentiel de production est estimé à plus de 7 000 m3/an toutes essences confondues.
L'exploitation est souvent rendue difficile à cause de la topographie et de la nature des terrains (pentes importantes, rivières à traverser ...). Parallèlement, le manque de formation et d'équipement des exploitants forestiers explique des volumes de vente historiquement limités. Ceci alors que le besoin en bois est de plus en plus croissant.
La gaulette
La gaulette est un petit bois, elle est utilisée par les agriculteurs comme tuteur pour les ignames et par les pécheurs pour les nasses. La demande est supérieure aux quantités disponibles. L’ONF travaille au contrôle des produits qui sortent de la forêt pour mieux répondre aux besoins du marché sans mettre en danger le renouvellement de la forêt.Le bambou
De l’ordre de 4000 tonnes par ans, le bambou est actuellement classé dans la catégorie des espèces envahissantes, ce qui conditionne l’approche de valorisation. On peut envisager les développements de plantations contrôlés pour produire une quantité exploitable dans le bâtiment.Noix de coco
Le gisement de la noix de coco est très faible : 160 tonnes par an. La noix de coco peut se valoriser en courte fibre que l’on peut intégrer dans briques de terre crue. C’est le fait qu’elle soit courte qui la prête à peu d’utilisation. Il est indispensable de penser un développement d’une plantation locale pour aller vers une valorisation de la ressource.La pierre
Actuellement, vingt carrières se partagent le territoire Guadeloupéen. L’activité des carrières fournit 4,22 millions de tonne de granulats durs d’origines volcanique et de Tuf calcaire. Elles permettent d’alimenter l’île pour la construction des routes, du béton. Cependant l’approvisionnement en granulat dur (nécessaire au béton) reste fragile, les réserves immédiates sont relativement faibles au regard des besoins grandissants de l’île. Aucune de ces carrières ne produit de la pierre de taille (ou dans de très petites quantités).La terre
Avec une dominance argileuse, nous avons vu que les sols en Guadeloupe sont classés en plusieurs catégories (voir point 2.1 de la présentation générale). La quantité d’argile dans la terre dépendra donc de l’endroit où elle aura été prélevée. Mais avec quelle terre pouvons-nous construire ? Le sol est composé de plusieurs couches /strates. La première couche est constituée de « terre végétale » utilisé pour la culture agricole. La seconde strate, est une couche « minérale » sans résidus. C’est cette dernière que nous allons utiliser pour construire en terre crue. Selon le mode de construction, on choisira des terres plus ou moins riche en argile, en sable, en gravier, etc… Nous pouvons imaginer que le gisement mobilisable viendra des terrassements effectués ou des déblais dû à la construction des fondations.L'agriculture
Le principal secteur économique en Guadeloupe est l’agriculture. L’agriculture de la canne à sucre et de la banane génère des déchets tels que des troncs de bananier, ou de la bagasse (résidu des tiges de canne à sucre dont on a extrait le jus). Actuellement la bagasse est brûlée pour créer de l’électricité dans les usines. Son gisement est estimé à 13000t/an. Si la banane est valorisée à l’export, le tronc du bananier peut être valorisé. On estime le gisement de ces troncs à moins de 5000 tonnes par an.Les sargasses
Les Sargasses sont des algues brunes de la famille des Sargassaceae. Avant 2011, les sargasses n’étaient pas un problème. Elles s’échouaient en très petites quantités sur les côtes, mais sans atteindre des volumes importants. C’est depuis 2015 que les quantités ont commencé à croître devenant ainsi une gêne pour l’économie et le tourisme antillais. Cette prolifération viendrait a priori d’une combinaison d’éléments tels que la déforestation de l’Amazonie[3]et les courants marins qui ramènent ces algues sur les côtes Antillaise. En mer, ces algues ne sont pas toxiques, mais une fois échouées sur les plages ou dans la mangrove, elles se décomposent et dégagent un gaz toxique : le sulfure d’hydrogène responsable d’odeurs nauséabondes et de risque pour la santé. Son gisement est estimé à 60 000t/an.es par an.3.2 - Les besoins en matière d’habitat
Une étude de la DEAL de 2014 montre qui faudrait produire entre 3000 et 4000 logements, suivant 3 scénarios, à terme en 2020 pour répondre au besoin de la population. Elle révèle aussi que la production de ces logements se diversifierai en trois points :- 19% L’évolution démographique
- 24% Le desserrement des ménages
- 48% Le renouvellement du parc immobilier
| Type de bâti | Nombre de logements | |
|---|---|---|
| Habitation de fortune | 1 025 | 0,6 % |
| Case traditionnelle | 3 068 | 1,8% |
| Maison ou immeuble en bois | 8 782 | 5,1 % |
| Maison ou immeuble en dur | 158 800 | 92,5 % |
| Total | 171 674 | 100 % |
3.3 La ressource logistique
L’approvisionnement de la Guadeloupe se fait par le port de Jarry, dans la commune de Baie-Mahault et le port de Basse-Terre. C’est principalement par le port Jarry que l’île communique avec le monde extérieur. Toutes les marchandises transitent via ce port.Non loin de la cote, au centre, se situe l’aéroport principal international de la Guadeloupe, il effectue la liaison aérienne avec le reste du monde. Bien que l’eau soit très présente autour de l’île, la circulation des ressources se fait principalement par voie routière. Les dépendances de la Guadeloupe sont reliées par voie maritime. Malgré le nombre important de rivières, il n’existe pas de transport fluvial. Cela est dû tout d’abord à la forte déclivité de la topographie, la présence de roche en surface et enfin de la faible profondeur de ces cours d’eau.
Durant les années 1800, l’exploitation industrielle sucrière a nécessité le développement du chemin de fer pour le déplacement des masses de cannes à sucre. À ce jour il existe plus qu’une ligne de transport ferroviaire active. Elle est utilisée à but touristique par l’usine de Beauport à Port Louis.
4 - Conclusion et ouverture
Pour conclure, nous avons vu que La Guadeloupe a des besoins en construction/reconstruction importants (intempéries, séismes). Ceux-ci génèrent une balance économique déficitaire (choix du béton qui est importé et augmentation des coût liés à la situation géographique isolée du continent). En conséquence la Guadeloupe a tout à fait intérêt à se pencher sur des solutions plus autarciques (matériaux bio-sources).Les pistes que nous mettons en avant sont celle de la mise en place de circuits courts, d’une économie circulaire et de l’hybridation des modes constructifs :
Le circuit court est un mode commercialisation des produits qui s’exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire entre l’exploitant et le consommateur. Il revêt d’une dimension locale, au plus régionale. Dans un milieu insulaire, la question des quantités est primordiale. En vue des besoins, l’offre ne satisfait pas la demande, il y a un déficit de matériaux à l’échelle d’une île. Un inventaire des ressources sur les autres îles pourra révéler un excédent de matériaux (mobilisé ou non) qui pourra être mis en réseau avec les autres îles de la Caraïbe. Après la mise en place de circuits courts entre les îles, est ce que les ressources excédentaires présentent sur les autres îles peuvent être complémentaires en fonction de leurs variétés et de leurs quantités ?
Le développement de circuits courts suggère celui de l’économie circulaire. « L’économie circulaire peut se définir comme un modèle économique (production et échanges) qui, dans l’idéal, fonctionne en boucle et réutilise systématiquement les déchets générés. En pratique, elle vise à limiter au maximum la consommation de matières premières, d’eau et l’utilisation des énergies non renouvelables, tout en prévoyant, dès la conception du produit (bien ou service), une durabilité optimale et la réutilisation ou le recyclage des matériaux en fin de cycle de vie. »[4]L’économie circulaire semble être une éventualité sur une île. Déchets papier, textiles recyclés, algues, déchets de l’agriculture sont des gisements mobilisables non valorisés qui existent en Guadeloupe. Ces déchets peuvent-ils faire l’objet d’une valorisation en matériaux de construction, dans leur quantité respective ?
L’hybridation des modes constructifs consiste à mélanger les modes constructifs en fonction de la disponibilité de la ressource et des caractéristiques de celle-ci. Mode constructif : « Manière et méthode de mise en œuvre du bâti en fonction du choix des matériaux. Formes particulières sous lesquelles se réalise tout ou partie de la construction d’un bâtiment.[5]L’hybridation est probablement nécessaire en Guadeloupe à partir du moment où (et un diagnostic approfondi est ici nécessaire) les ressources locales pour un matériau donné sont très certainement insuffisantes pour satisfaire les besoins en matière de construction. En revanche, combiner plusieurs matériaux et/ou modes constructifs permettrait de répondre plus efficacement à la demande. Il faudra que ces modes de constructions employant des matériaux différents et locaux puissent d’une part être compatibles entre eux, d’autre part qu’ils soient adaptés au climat (voir tableau si dessous).
Nous faisons l’hypothèse que la solution réside probablement dans une combinaison de ces pistes qui reste à trouver en fonction des résultats de l’analyse de chacune de ces dernières. A développer, pourquoi pas, dans de futurs travaux.
Références
-
- « 161031 Rapport materiaux biosources Guadeloupe 2016.pdf », s. d.
- Angeon, Valérie, et Pascal Saffache. « Les petites économies insulaires et le développement durable : des réalités locales résilientes ? » Études caribéennes, no11 (1 décembre 2008). http://journals.openedition.org/etudescaribeennes/3443.
- Bahers, Jean-Baptiste, Mathieu Durand, et Hélène Beraud. « Quelle territorialité pour l’économie circulaire ? Interprétation des typologies de proximité dans la gestion des déchets ». FluxN° 109-110, no3 (8 décembre 2017): 129‑41.
- « Commerce extérieur agroalimentaire », s. d.
- « Diagnostic et enjeux stratégiques en matière d’habitat DEAL.pdf », s. d.
- « Dossier complet − Département de la Guadeloupe (971) | Insee ». Consulté le 19 décembre 2018. https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-971#graphique-POP_G2.
- « D’où viennent les sargasses qui envahissent les côtes antillaises ? » People Bo Kay(blog), 31 mars 2018. https://www.people-bokay.com/dou-viennent-les-sargasses-qui-envahissent-les-cotes-antillaises/.
- Fomoa-Adenet, Madly, et Laurent Rieutort. « Territoires ruraux insulaires et développement durable ». Études caribéennes, no11 (1 décembre 2008). https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.3454.
- Fontaine, Philippe. « Les circuits courts rapprochent les producteurs des consommateurs », 21 décembre 2016. http://www.inra.fr%2FGrand-public%2FEconomie-et-societe%2FTous-les-dossiers%2FCircuits-courts-du-producteur-au-consommateur.
- Guadeloupe, DAAF. « Vingt ans de commerce extérieur : 1995 – 2015 », 18 septembre 2017. http://daaf.guadeloupe.agriculture.gouv.fr/Vingt-ans-de-commerce-exterieur.
- Guillard, Valérie. « D’une économie linéaire à une économie circulaire ». Economie et Management, no168 (2018). https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01891422.
- « La transformation des troncs de bananier ». Consulté le 6 décembre 2018. https://www.caraibe-agricole.com/fr/innovations/recherche/item/100-la-transformation-des-troncs-de-bananier.
- « Le schéma des carrières de la Guadeloupe », s. d.
- « L’histoire de FIBandCO, créateur de Green Blade, revêtement décoratif haut de gamme en fibres végétales de troncs de bananiers ». Consulté le 6 décembre 2018. http://www.fibandco.fr/fib-and-co.php.
- « L’impossible développement de la Guadeloupe ou, est-il encore possible de changer les règles du jeu ? – Perspektives ». Consulté le 16 décembre 2018. http://www.perspektives.org/2016/09/14/limpossible-developpement-de-la-guadeloupe-ouest-il-encore-possible-de-changer-les-regles-du-jeu/.
- Marie-Lise, MARCL-ROCHE. « Les échanges commerciaux de la Guadeloupe en 2016 », 2016, 6.
- « ONF – Aménager et valoriser le patrimoine forestier ». Consulté le 17 décembre 2018. http://www.onf.fr/guadeloupe/onf_guadeloupe/guadeloupe/missions/20150824-133546-679892/@@index.html.
- « Repère : construire en terre crue ». Consulté le 1 janvier 2019. http://passerelles.bnf.fr/reperes/terre_crue_01.php.
- « Sargasses, causes et conséquences | Parc national de la Guadeloupe ». Consulté le 18 décembre 2018. http://www.guadeloupe-parcnational.fr/fr/des-connaissances/les-missions-scientifiques/lactualite-scientifique/sargasses-causes-et.
Annexe
Tableau 2 – État des lieux des ressources en Guadeloupe
[2]Rapport matériaux biosources Guadeloupe 2016 KARIBATI
[3]Il semble en effet que les nutriments contenus dans l’eau de l’Amazone et L’Orénoque profitent à la croissance de ces algues et favorisent leur développement massif. Ce phénomène devrait malheureusement se reproduire, voire s’accentuer les prochaines années, en raison de la destruction massive de la mangrove d’Amérique latine, qui permettait auparavant de retenir une grande partie des nutriments provenant des fleuves.
Il met l’accent sur les conséquences que peuvent produire les déforestations et urbanisations incontrôlées.
[4]https://e-rse.net/definitions/economie-circulaire-definition-enjeux-et-mise-en-oeuvre/#gs.UTvrluQD